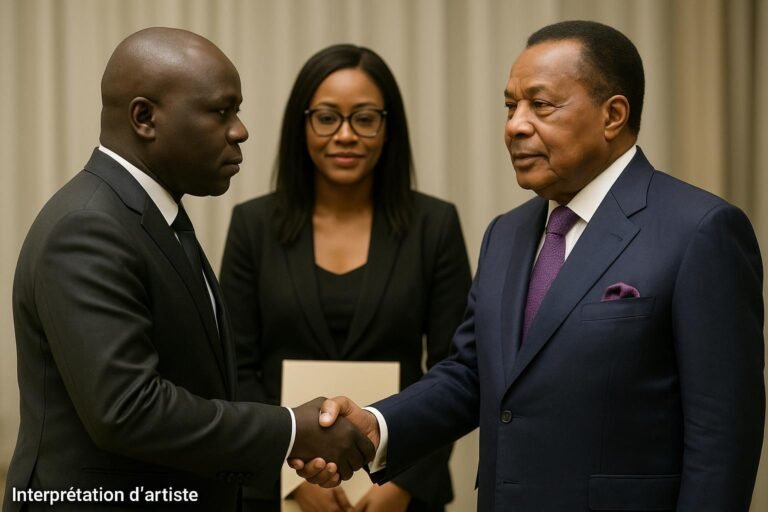Un corridor vital pour deux économies enclavées
Sur les rives de l’Oubangui, la boucle logistique reliant Brazzaville à Bangui fait figure d’artère vitale. Le 6 août, Denis Sassou Nguesso a reçu l’émissaire du président centrafricain, la ministre des Affaires étrangères Sylvie Baïpo-Temon, accompagnée de son collègue des Transports, Arnaud Djoubaye Abazene. Les échanges ont porté sur la relance d’un flux fluvial qui assure, pour la Centrafrique, plus de 70 % des importations de carburant et d’intrants de première nécessité, tout en offrant au Congo un débouché naturel pour ses produits manufacturés et agricoles.
Depuis les années 1960, ce corridor a permis aux commerçants du Plateau des Bateke ou du Pool de joindre les marchés de Bangui sans transiter par la mer. Cependant, l’âge des barges, l’ensablement récurrent et les aléas sécuritaires ont progressivement réduit la cadence des convois, passant de près de 300 000 tonnes par an dans les années 1990 à moins de 120 000 tonnes aujourd’hui, selon les chiffres croisés des deux ministères des Transports.
Des infrastructures à moderniser d’urgence
Le diagnostic partagé par les délégations pointe la vétusté des quais de la société congolaise SCEVN à Brazzaville comme celle du port de Salo, porte d’entrée de Bangui. Le dragage, interrompu faute de balises fonctionnelles et de financements réguliers, contraint désormais les barges à naviguer à moitié charge sur certains tronçons de l’Oubangui.
« Il est crucial de travailler sur le renforcement de cette connexion fluviale », a martelé Sylvie Baïpo-Temon, rappelant que plusieurs villages côtiers vivent exclusivement de la pêche et du petit commerce générés par le passage des péniches. Côté congolais, l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie fluviale table sur un investissement initial de 25 milliards de FCFA pour rénover les balises, remettre en service deux remorqueurs et informatiser la gestion des escales.
Une dynamique régionale portée par la Cémac
Au-delà des considérations techniques, Brazzaville et Bangui voient dans cette reprise un jalon clé de l’intégration sous-régionale. Le 9 août prochain, la seizième session ordinaire des chefs d’État de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale se tiendra à Bangui. Faustin Archange Touadéra y transmettra la présidence tournante de la Cémac à Denis Sassou Nguesso, ouvrant une fenêtre diplomatique propice à la concrétisation de projets transfrontaliers.
La Banque de développement des États de l’Afrique centrale, adossée au Fonds africain de développement, a déjà inscrit à son portefeuille 50 millions d’euros pour la modernisation du corridor fluvial, assortis d’un volet formation pour les pilotes de ligne de l’Oubangui. « Il s’agit d’un outil de souveraineté collective », juge un expert du Secrétariat permanent de la Cémac, pour qui la libre circulation des marchandises reste la condition de la diversification économique.
Vers une diplomatie du fleuve assumée
Dans un contexte géopolitique où la fluidité des routes terrestres reste contrariée par l’instabilité de certains axes, le fleuve s’impose comme un pont naturel et pacifique. En le dotant d’infrastructures adaptées aux exigences du commerce contemporain, le Congo et la Centrafrique entendent démontrer que la coopération peut surmonter les contraintes physiques et politiques.
Le calendrier arrêté à Brazzaville prévoit la signature d’un protocole d’accord technique avant la fin de l’année, puis la mise à flot d’une première flotte rénovée au premier semestre 2025. À l’heure où la Cémac cherche à accélérer la mise en œuvre de sa zone de libre-échange, la résurrection du corridor fluvial Brazzaville-Bangui pourrait servir de modèle à d’autres initiatives inter-états axées sur les infrastructures durables et l’économie bleue.