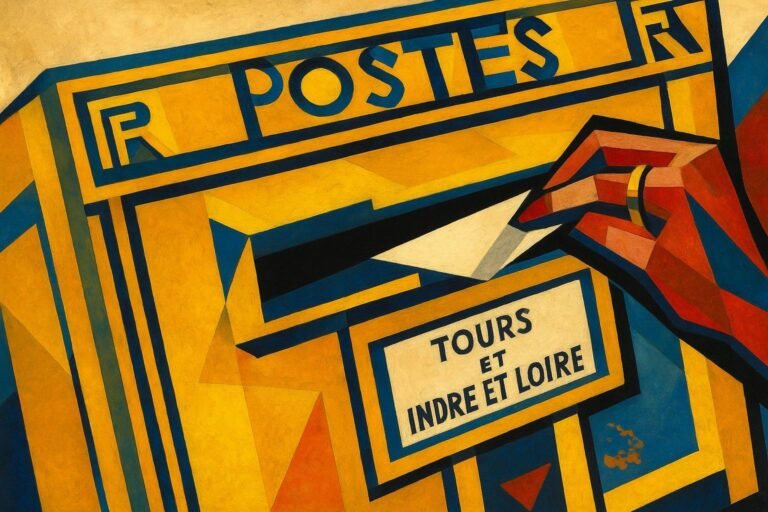Présidentielle 2026 : un terrain fertile aux intox
Plus l’échéance électorale de mars 2026 se rapproche, plus l’espace public congolais bruisse de confidences invérifiables, de fausses révélations et de récits complotistes qui, en quelques heures, parcourent WhatsApp, Facebook ou Telegram. Le phénomène n’est certes pas nouveau, mais il change d’échelle : la rumeur, jadis chuchotée dans les marchés, bénéficie désormais de la puissance algorithmique qui amplifie chaque émotion au-delà des frontières de Brazzaville.
Le politologue Éric Mbemba rappelle que « la rumeur devient performative dès qu’elle se combine à l’image et à la vitesse ». Selon une étude de l’Université Marien-Ngouabi, une information non sourcée circule trois fois plus vite qu’un communiqué officiel. Ce décalage alimente une concurrence perverse entre la patience nécessaire à la vérification des faits et l’impatience propre à la consommation d’alertes en continu.
Or, dans le contexte de stabilité institutionnelle que le Congo-Brazzaville s’attache à préserver, la viralité d’une fausse nouvelle peut fragiliser la cohésion sociale en attisant méfiance et crispations identitaires. D’où l’importance, rappelée par plusieurs ministères, de « laisser la vérité mettre ses chaussures » avant de partager un contenu.
Mécanismes viraux de la post-vérité numérique
Le concept de post-vérité, popularisé par le dictionnaire d’Oxford en 2016, désigne une situation où les faits cèdent leur primauté aux affects. Sur les timelines congolaises, un montage photo habilement retouché suscite souvent davantage de commentaires qu’un rapport officiel pourtant publié en libre accès.
Les psycho-sociologues évoquent le biais de confirmation : chacun tend à “liker” ce qui conforte ses intuitions. C’est ainsi que l’allégorie du mensonge dérobant les habits de la vérité, racontée depuis l’Antiquité, prend aujourd’hui la forme d’un meme partagé sur des centaines de comptes. « Les plateformes ont transformé l’émotion en monnaie d’échange », observe Sonia Ndinga, chercheuse associée à l’UNESCO, pour qui l’enjeu n’est pas tant technologique que citoyen : cultiver le doute constructif plutôt que l’indignation réflexe.
La spécificité congolaise réside dans la porosité entre information traditionnelle et contenus viraux : une émission de radio locale peut reprendre sans vérification un tweet trompeur, lequel acquiert alors la respectabilité de l’antenne. Ce cercle renforce la crédibilité d’assertions non étayées et accroît le risque de tensions sociales.
Cadre légal congolais et initiatives citoyennes
La loi de 2019 sur la communication numérique prévoit déjà des sanctions graduées contre la diffusion volontaire de fausses nouvelles susceptibles de troubler l’ordre public. Le régulateur, l’ARPCE, a récemment rappelé qu’« une liberté d’expression solide suppose une information loyale ». L’esprit du texte n’est pas de museler l’opinion, mais d’exiger la traçabilité des sources lorsqu’un contenu est diffusé à large échelle.
Sur le volet pédagogique, le ministère de l’Enseignement supérieur a introduit un module de littératie médiatique dans trois universités publiques. Des ateliers pratiques invitent les étudiants à vérifier une vidéo via la recherche inversée d’images ou à confronter une citation à des bases de données factuelles. « La formation d’un citoyen numérique avisé est le meilleur antidote aux rumeurs », explique la professeure Clarisse Ossébi.
Parallèlement, plusieurs organisations de la société civile, telles que Les Observateurs du Pool ou le collectif Fact-Congo, lancent des campagnes « Stop intox ». Leurs infographies, largement reprises, démontrent qu’une approche collaborative permet de contrecarrer les discours manipulateurs sans recourir à la censure.
Vers une hygiène informationnelle collective
Les spécialistes insistent : aucune législation ni algorithme ne suffiront si l’internaute demeure passif. À l’instar des gestes barrières sanitaires, une hygiène informationnelle simple – croiser les sources, attendre une confirmation indépendante, éviter le partage impulsif – protège la communauté tout entière.
Dans un message radiodiffusé le mois dernier, le président Denis Sassou Nguesso a exhorté les jeunes à « faire triompher la raison sur la rumeur ». Ce rappel à la responsabilité individuelle complète les dispositifs institutionnels, reflétant une vision où la modernité numérique s’accommode d’une éthique du dialogue.
Le bain quotidien dans le flux des notifications ne condamne donc pas le citoyen congolais à la crédulité. Il ouvre, au contraire, la possibilité d’un espace public plus exigeant, où la vérification devient un réflexe et où la parole authentique, même moins spectaculaire, retrouve sa place. La vérité, peut-être encore pieds nus, n’a pas dit son dernier mot.