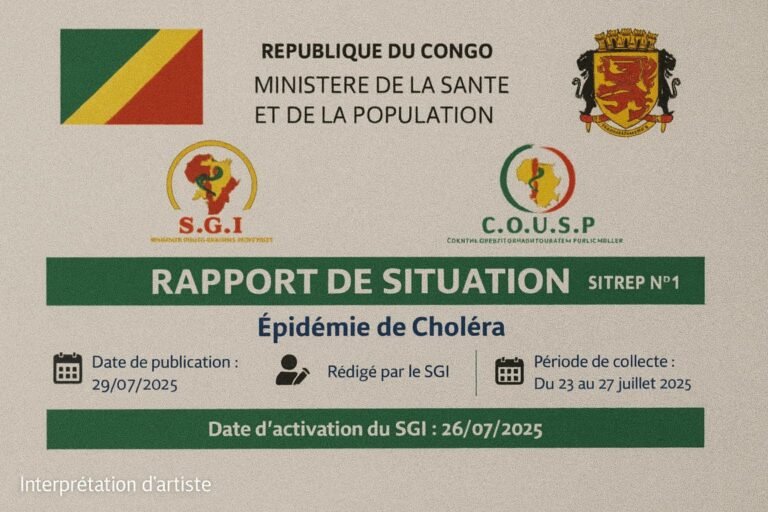Un sursaut sanitaire piloté au sommet de l’État
Le 25 juillet 2025, le ministère congolais de la Santé, appuyé par l’Organisation mondiale de la Santé, a publié un premier rapport de situation attestant de foyers de choléra localisés dans les départements du Kouilou et du Pool. Les autorités, conscientes de la charge symbolique attachée à une pathologie souvent associée au manque d’infrastructures, ont choisi la transparence articulée à une stratégie d’anticipation. « Nous devons casser la chaîne de transmission avant qu’elle ne s’installe », a résumé le directeur de cabinet du ministre, insistant sur la mobilisation immédiate des stocks de sels de réhydratation orale et la désinfection systématique des adductions d’eau (OMS, 25 juillet 2025).
La cellule interministérielle de crise, placée sous l’égide de la primature, se réunit chaque matin depuis l’alerte initiale. Cette centralisation de la décision, familière aux observateurs des politiques publiques congolaises, permet une coordination rapide entre l’Armée, la Protection civile et les autorités sanitaires locales. Les premiers résultats sont tangibles : le taux de létalité, inférieur à 1 %, demeure parmi les plus bas des dernières flambées régionales, signe d’une surveillance épidémiologique en progrès constant.
Eaux fluviales, saison sèche et vulnérabilité communautaire
Au-delà de l’urgence médicale, la configuration hydrologique congolaise exerce une influence directe sur la dissémination du Vibrio cholerae. La décrue du fleuve Congo, caractéristique de la saison sèche, concentre les déchets sur les rives et fragilise les points de captage. Les experts alertent sur la porosité des frontières fluviales, notamment vers la province voisine du Mai-Ndombe en République démocratique du Congo, où des cas isolés ont été recensés en juin. Les équipes techniques ont donc installé des postes de chloration portatifs dans les débarcadères et distribué des tablettes de purification aux pêcheurs itinérants.
Le défi est également social : l’exode rural, accentué par les chantiers pétroliers du littoral, a densifié les quartiers informels de Pointe-Noire, rendant plus complexe la gestion des eaux usées. Les municipalités, dotées de cagnottes spéciales issues du Fonds national de solidarité, multiplient les campagnes de porte-à-porte pour promouvoir le lavage des mains et la cuisson prolongée des aliments. Cette diplomatie de proximité, peu spectaculaire mais décisive, se double d’un contrôle médiatique visant à éviter la propagation de fausses rumeurs susceptibles d’entraver les équipes de terrain.
Partenariats internationaux : l’OMS en chef d’orchestre
Si l’épidémie reste contenue à ce stade, c’est aussi grâce à une synergie régionale soignée. L’OMS coordonne l’envoi de kits de laboratoire et d’unités de traitement d’eau, tandis que le Centre africain de contrôle des maladies fournit des épidémiologistes pour la cartographie des cas. La France, historiquement partenaire dans la formation des cadres de santé, a annoncé une rallonge de 500 000 euros destinée au renforcement de la surveillance transfrontalière. « Le Congo a tiré les leçons des épisodes de 2011 et 2018, l’approche est désormais basée sur la science et la redevabilité », observe le professeur Alain Okemba, chargé de cours à l’Université Marien-Ngouabi.
Cet engagement extérieur ne minimise pas le rôle de la société civile congolaise, qui assure la veille communautaire et la remontée d’informations. Les radios locales, soutenues par l’UNICEF, diffusent des messages en lingala, kituba et vili, garantissant l’accessibilité linguistique des consignes sanitaires. Cette pluralité de voix participe à la stabilité perceptible, évitant l’écueil d’une réponse exclusivement verticale.
Vers une résilience structurelle et durable
L’enjeu, désormais, est de transformer la riposte urgente en investissement pérenne. Brazzaville planche sur un plan d’amélioration des systèmes d’eau potable prévoyant la réhabilitation de 120 kilomètres de canalisations d’ici à 2027, un calendrier jugé ambitieux mais réaliste par les bailleurs. La Banque mondiale a déjà alloué dix millions de dollars pour la première phase, concentrée sur les captages ruraux.
À court terme, la vaccination orale, recommandée par le Groupe stratégique consultatif d’experts, est à l’étude. Le pays dispose de 800 000 doses stockées dans l’entrepôt central de Makélékélé, un effectif suffisant pour vacciner les populations riveraines les plus exposées si la tendance épidémiologique l’exige. Le gouvernement, prudent, attend la confirmation du Centre national de référence avant de déclencher la campagne.
La dynamique observée offre une illustration instructive des capacités d’adaptation de l’État congolais face aux menaces sanitaires. En articulant gouvernance centralisée, partenariats internationaux et mobilisation communautaire, Brazzaville entend empêcher le choléra de devenir « l’invité permanent » redouté par tous les épidémiologistes. Le défi est certes exigeant, mais les fondations d’une résilience structurelle se consolident, augurant d’une prise en charge plus autonome des crises sanitaires futures.